Histoire de la Prohibition
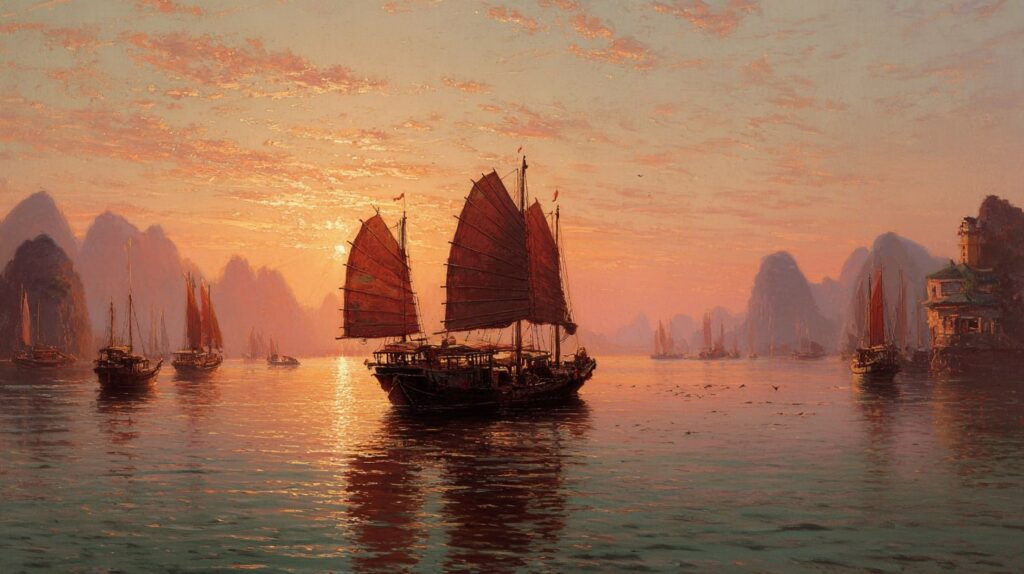
L’histoire de la Prohibition remonte à très loin et repose sur des bases plus que fragiles et largement contestables. S’informer sur l’histoire doit nous permettre de préparer un meilleur avenir.
2014 – Les états modifiés de conscience sont-ils nuisibles, neutres ou utiles pour les origines de la cognition symbolique ? Une réponse à Hodgson et Lewis-Williams
Nous répondons aux commentaires de Hodgson et Lewis-Williams en clarifiant la nouveauté de notre théorie. Nous soutenons que lorsque les instabilités de Turing de l’activité neuronale jouent un rôle dans la génération d’hallucinations visuelles, elles font plus que simplement façonner les motifs géométriques. Leur auto-organisation relativement autonome est une source de valeur intrinsèque liée à leur auto-maintien en tant que motif d’activité, et elles dissocieraient ainsi les étapes « supérieures » du traitement neuronal des stimuli externes, facilitant ainsi un mode de cognition plus abstrait. Ces caractéristiques supplémentaires de notre proposition soutiennent Hodgson et Lewis-Williams dans leurs théories respectives sur les origines mêmes de l’activité artistique humaine. Nous évaluons également la littérature critique concernant la possibilité d’une mise en œuvre ritualisée des états modifiés de conscience (ASC) au début de la préhistoire. Nous concluons que les ASC étaient effectivement possibles et suggérons qu’ils ont probablement contribué à faciliter le développement social de formes de vie et d’esprit plus symboliques.
2015 – Les origines de l’ivresse : preuves archéologiques de la consommation de boissons fermentées et de drogues dans l’Eurasie préhistorique
Les premiers témoignages de la consommation d’alcool et de drogues suggèrent que l’ivresse est une pratique ancienne, dont les origines remontent à la préhistoire. Des traces très évocatrices de boissons fermentées et des restes de plantes psychoactives ont été retrouvées sur des sites archéologiques à travers toute l’Europe préhistorique. Cet article retrace l’histoire de ces substances dans une approche culturelle basée sur les contextes de consommation. Un large éventail de documents sera examiné ici (restes macrofossiles de plantes psychoactives, résidus de boissons fermentées, alcaloïdes dans des objets archéologiques et représentations artistiques, entre autres). Étant donné que ces produits altérant les sens se trouvent principalement dans des tombes et des lieux cérémoniels, ils semblent être étroitement liés à des usages rituels. Loin d’être consommées à des fins hédonistes, on peut donc affirmer que les plantes médicinales et les boissons alcoolisées jouaient un rôle sacré dans les sociétés préhistoriques.
2019 – Utilisation cérémonielle de la « médecine par les plantes » et son lien avec la consommation récréative de drogues : une étude exploratoire
L’usage cérémoniel de substances psychoactives/hallucinogènes à base de plantes, telles que l’ayahuasca, la psilocybine et autres, est une tendance croissante aux États-Unis et dans le monde entier. À ce jour, peu de recherches ont été menées pour déterminer combien de personnes consomment des substances psychoactives dans ce contexte, qui sont les consommateurs, quels sont les avantages/risques liés à l’usage de ces substances et quelle est la relation entre l’usage cérémoniel et l’usage récréatif de ces substances.
2002 – Recherche de substances psychotropes : pathologie évolutive ou adaptation ?
Selon une perspective évolutionniste conventionnelle, la propension humaine à consommer des substances est le résultat d’un « décalage » entre les mécanismes émotionnels qui se sont développés dans un passé où il n’existait pas de drogues pures ni de voies d’administration directe, et l’apparition de ces phénomènes dans l’environnement contemporain.
2021 – Psychédéliques, sociabilité et évolution humaine
Nos ancêtres hominidés ont inévitablement rencontré et probablement ingéré des champignons psychédéliques tout au long de leur histoire évolutive. Cette affirmation est étayée par les connaissances actuelles sur : le paléo-régime alimentaire et la paléoécologie des premiers hominidés ; la phylogénie des primates en matière de comportements mycophages et auto-médicaux ; et la biogéographie des champignons contenant de la psilocybine.
2019 – Les données archéologiques les plus anciennes attestant de la relation entre l’Homo Sapiens et les plantes psychoactives : un aperçu mondial
Les instruments archéométriques modernes sophistiqués sont de plus en plus capables de détecter la présence de sources végétales psychoactives dans des contextes archéologiques, témoignant ainsi de l’ancienneté de la quête humaine pour atteindre des états de conscience modifiés. L’objectif de cet article est de fournir une vue d’ensemble de ces découvertes, en couvrant les principales sources végétales psychoactives dans le monde et en identifiant les dates les plus anciennes attestées à ce jour par l’archéologie. Cette revue s’appuie sur la littérature archéologique identifiant la présence de sources végétales psychoactives, en s’appuyant sur des documents de recherche originaux. La recherche a abouti à deux résultats principaux : (a) une systématisation des types de preuves archéologiques qui témoignent de la relation entre Homo sapiens et ces sources psychoactives, subdivisées en preuves directes (c’est-à-dire les découvertes matérielles, chimiques et génétiques) et des preuves indirectes (c’est-à-dire anthropophysiques, iconographiques, littéraires et paraphernalia) ; et (b) la production d’une liste des dates les plus anciennes connues de la relation entre H. sapiens et les principales sources végétales psychoactives. Il semble y avoir une diffusion générale de l’utilisation des plantes médicinales depuis au moins le Néolithique (pour l’Ancien Monde) et la période préformative (pour les Amériques). Ces dates ne doivent pas être comprises comme la première utilisation de ces substances, mais renvoient aux dates les plus anciennes actuellement déterminées par des preuves archéologiques directes ou indirectes. Plusieurs de ces dates sont susceptibles d’être modifiées à la baisse par de futures fouilles et découvertes.
2016 – Sur l’origine du genre Psilocybe et son utilisation rituelle potentielle dans l’Afrique et l’Europe anciennes
Le rôle des états modifiés de conscience dans la production d’art géométrique et figuratif par les cultures préhistoriques en Afrique et en Europe a fait l’objet de vifs débats. Helvenston et Bahn ont tenté de réfuter l’hypothèse la plus célèbre, le modèle neuropsychologique de Lewis-Williams, en affirmant que les hallucinations visuelles appropriées nécessitaient l’ingestion de LSD, de psilocybine ou de mescaline, tout en soutenant qu’aucun de ces composés n’était accessible aux cultures en question. Nous présentons ici des arguments mycologiques qui racontent une autre histoire. La distribution préhistorique mondiale du genre de champignons Psilocybe, et donc de la psilocybine, est corroborée par l’existence d’espèces endémiques en Amérique, en Afrique et en Europe, par la distribution disjointe d’espèces sœurs et par la possibilité d’une dispersion des spores sur de longues distances. Il est plus difficile de mettre en évidence des exemples concrets d’utilisation rituelle préhistorique en Afrique et en Europe, mais les découvertes suggestives se multiplient.
2015 – Les substances psychoactives à l’époque préhistorique : examen des preuves archéologiques
La relation entre les êtres humains et les substances psychoactives remonte à plusieurs millénaires. Cet article vise à fournir un aperçu complet de la consommation de plantes médicinales et de boissons fermentées à l’époque préhistorique en s’appuyant sur quelques exemples archéologiques du monde entier qui illustrent l’utilisation précoce de ces substances. Les preuves archéologiques de l’existence de substances psychoactives sont évaluées à la lumière de certains indicateurs à prendre en considération lors de l’examen de ce type de données.
2005 – Utilisation préhistorique du peyotl : analyse des alcaloïdes et datation au radiocarbone de spécimens archéologiques de Lophophora provenant du Texas
Deux spécimens archéologiques de boutons de peyotl, c’est-à-dire les sommets séchés du cactus Lophophora williamsii (Lem.) Coulter, provenant de la collection du Witte Museum de San Antonio, ont été soumis à une datation au radiocarbone et à une analyse alcaloïde. Les échantillons ont vraisemblablement été trouvés dans la grotte Shumla n° 5 sur le Rio Grande, au Texas. La datation au radiocarbone montre que l’âge calibré au 14C de la moyenne pondérée des deux échantillons datés correspond à l’intervalle calendaire 3780-3660 avant J.-C. (signification d’un sigma). L’extraction des alcaloïdes a donné environ 2 % d’alcaloïdes. L’analyse par chromatographie en couche mince (CCM) et chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) a permis d’identifier la mescaline dans les deux échantillons. Aucun autre alcaloïde du peyotl n’a pu être identifié.
